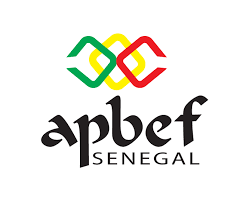PAR IBRAHIMA MAIGA
A seulement 24 ans, le destin de Aline Sitoë Diatta s’est accompli tragiquement à Tombouctou en 1944. Elle y avait été condamnée à purger une peine d’internement de dix ans ; elle n’a pas tenu un an, victime du scorbut
Ibrahima MAIGA | Publication 24/04/2021
A seulement 24 ans, le destin de Aline Sitoë Diatta s’est accompli tragiquement à Tombouctou en 1944. Elle y avait été condamnée à purger une peine d’internement de dix ans ; elle n’a pas tenu un an, victime du scorbut. A Tombouctou, la mémoire locale n’a pas gardé d’elle beaucoup de souvenirs . Par contre, au Sénégal, le débat sur le rapatriement de ses restes est encore d’actualité dans un contexte où l’engagement mémoriel toise la lecture politique.
On en sait beaucoup sur Gbéhanzin , Samori, Chérif Hamahoullah, tous capturés et brandis comme des fauves de foire avant d’être déportés dans des territoires aux conditions climatiques rudes ; en Martinique, en Guinée, en Côte d’Ivoire, en Mauritanie, au Gabon, à Madagascar, au Soudan français,… S’y ajoute le flot d’assignation à l’intérieur de chacun des territoires colonisés par la France, la « grande nation des droits de l’Homme ». C’était l’époque des « camps d’internement », des « camps d’enfermement administratif » et même des « camps de concentration » sous les tropiques, dans l’ombre de la deuxième guerre mondiale !
Aline Sitoë Diatta, elle, a été « affectée » au Soudan français. D’armes, elle n’avait que son intelligence ! De munitions, elle n’avait que son charisme, et son verbe ! Elle n’a pas été jugée par un tribunal, car l’administration n’a jamais pu réunir contre elle des preuves. Elle a cependant été condamnée à « internement administratif à titre préventif » parce que son engagement en faveur de l’autonomie et de la renaissance de son peuple dérangeait. Mue par une force intérieure propre à l’univers animiste des diolas de la Casamance, Aline était tout simplement un leader. Elle avait des pouvoirs mystiques.
Le Lieutenant-Colonel Sajous, Commandant du cercle de Ziguinchor, à l’époque des faits, donne un portrait de Aline en ces termes : « Servie par le prestige d'avoir procuré aux Diolas un hivernage très pluvieux gage d'une excellente récolte de riz et succédant à une année 1941 sèche, elle prescrivait à son entourage de féticheurs de ne pas obéir aux Blancs, de leur refuser les hommes pour le service militaire, de ne pas accepter les achats obligatoires de paddy, de ne pas entretenir les routes » (Archives d'outre-mer d' Aixen-Provence, 14 MI 1835 2G 42, Rapport politique du Sénégal). Ce court extrait résume la volonté du colonisateur d’en finir avec elle. Ces propos seront confortés par Christian Roche, un historien, le dernier proviseur français du lycée de Ziguinchor, dans un article intitulé « Chronique casamançaise.
Le cercle de Ziguinchor au Sénégal pendant la guerre de 1939-1945 » ( Revue des Outre- Mères, revue d’histoire, 1986) . D’après Roche, parce que justement Aline avait une aura et un discours nationaliste, qui débouchait sur une sorte de subversion, le Lieutenant-Colonel Sajous a décidé « de frapper les imaginations ». Pour le militaire français, Aline Sitoé pouvait être considérée comme « l'inspiratrice des troubles » ayant secoué la Casamance. Cette déduction était suffisante pour justifier qu’il se rende en mission dans la zone d’évolution de Aline. Sajous est d’une grande barbarie. Il tue, frappe et menace de mettre le feu à tous les villages. Pour couper court à cette barbarie qui s’abattait sur des innocents, Aline a préféré se rendre. Roche précise que cet évènement a lieu le 31 janvier vers midi. « … la jeune prophétesse, appuyée sur des cannes en raison d'une infirmité congénitale, vint se livrer aux Français afin d'éviter toute effusion de sang », rapporte l’historien. Mais Sajous n’est pas content. Il veut humilier la nationaliste et la gifle ; ce qui ne passe pas .
Captive désormais, elle prend la direction de Ziguinchor en même temps que certains de ses proches, entre 20 et 23 personnes. Elle sera condamnée à la déportation. Dans un premier temps, elle est à Kayes. Elle finira par Tombouctou. L’historien sénégalais Papis Comakha Fall qui a travaillé sur les mêmes faits « Automne-hiver 2020 » (page 19, n° 9-10 ), insiste sur le caractère pacifique de la lutte engagée par Aline Sitoë Diatta. Malgré tout, l’armée française avait décidé de la réduire en silence avec la consigne suivante : « faire respecter les ordres, arrêter les rebelles et mettre fin par la force, à toute tentative de rébellion jusqu’à la soumission complète ». (Télégramme lettre n° 31 adressée au gouverneur général de l’AOF, Saint Louis, 22 janvier 1943). Dès lors, les mobiles ne devaient plus être compliqués. Ils seront condensés en trois points : « mensonges, escroquerie et rébellion ». Pour Roche, Aline a été condamnée « administrativement », parce qu’elle tenait un « message religieux qui préconisait un retour au riz rouge, au lieu du riz blanc recommandé par les Français, par sa prédiction que les Blancs partiraient un jour… . ».
La condamnation devenait possible du seul fait de l’application du décret colonial du 15 novembre 1924, une des illustrations du régime de l’indigénat. La volonté qui sous-tendait l’invocation de ce texte qui autorisait tous les abus était qu’ « il importe au plus haut point pour le retour de la tranquillité dans le pays que la visionnaire Aline Sitoë Diatta et ses adeptes soient écartés pour longtemps des lieux où ils ont exercé leur emprise ». ( Rapport d’ensemble tendant à faire interner la dame de Kabrousse, Aline Sitoë Diatta et ses principaux adeptes, 1943). L’autorité coloniale parle de la « rebellion d’Effok et des villages environnants qui croient, à la lettre, aux promesses que ( Aline) leur avaient faites » ( Archives Nationales du Sénégal, Rapport d’interrogatoire du 15 mars 1943). Aline Sitoë est donc coupable. Sur sa condamnation-même , nous n’avons pas trouvé meilleure source que Papis Fall. Il écrit que Aline Sitoë a été condamnée le 15 juin 1943, par un Arrêté général du Gouverneur. Le prononcé de l’acte admnistratif précise qu’il s’agit d’une peine de « dix ans de réclusion à passer dans le cercle de Kayes ». ( procès verbal d’interrogatoire du 15 mars 1943). On retrouve donc la trace de Aline à Kayes, mais pour quelques temps seulement.
L’administration a soudainement pris la décision de durcir les conditions de détention de la prisonnière en l’envoyant à Tombouctou. Le 27 août 1943, est pris l’arrêté qui fixe désormais son lieu de détention à Tombouctou. ( Histoire d’Aline Sitoë : mourir à Tombouctou, Soleil, mardi 11 octobre 1983, p.2). On sait maintenant que le « voyage » de Aline a été préparé à partir de Kayes. De Kayes, elle a embarqué dans un train pour Bamako et de Bamako à Koulikoro, le terminus du « Dakar-Niger » . De Koulikoro, elle a pris un bateau pour Tombouctou. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à Aline Sitoë Diatta, il faut se placer dans le contexte de la deuxième guerre mondiale ; une guerre qui a ébranlé la France, dans ses fondements. En un quart de tour, Hitler a occupé Paris.
La France est divisée entre ceux qui pensaient qu’il fallait collaborer avec l’occupant nazi (Vichy, Pétain et consorts) et ceux qui appelaient à la résistance ( De Gaulle et alliés). La défaite de la France a eu un écho énorme dans les colonies. Mais la « puissance » ne voulait pas montrer de faiblesse. Les administrateurs fidèles à Vichy vont s’évertuer à briser toute forme de résistance locale. C’est dans ce contexte qu’il faut situer les évènements qui vont placer au devant de la scène Aline Diatta et Chérif Hamaoullah, entre 1941 et 1943. Voilà, pourquoi Aline a été mise aux arrêts et déportée à Tombouctou. La symbolique est forte. Aline Sitoë provient d’un milieu fondamentalement animiste. La condamner et l’interner à Tombouctou, une ville pieuse musulmane, était un autre supplice. Les colonisateurs ont apparemment vite réussi leur besogne. La résistante vivra à peine un an.
LA POLEMIQUE ET LA RECUPERATION
Le rapatriement des restes de Aline Sitoë est toujours de haute importance politique et stratégique au Sénégal. La question avait été soulevée depuis, sous le Président Senghor, dans la ligne de mire de l’indépendance du pays en 1960. Sans succès. Le 15 décembre 2011, une décision du Conseil des ministres du Sénégal s’est emparée du sujet. On y lit que : « Le Chef de l'Etat a, …, tenu à faire une déclaration solennelle sur sa volonté de faire rapatrier les restes de l'héroïne nationale Aline Sitoë DIATTA, très jeune résistante, enlevée puis déportée à Tombouctou au Mali où elle est décédée et enterrée dans un petit cimetière ….. Il a déjà obtenu l'autorisation du Président du Mali pour un éventuel rapatriement des restes d'Aline Sitoë DIATTA.
A cet effet, le Chef de l'Etat a instruit le Conseil de mettre en place une Commission, présidée par le Dr Christian Sina DIATTA et composée d'historiens, de chercheurs et de cadres casamançais, qui devra, suivant ses instructions, se rapprocher des autorités coutumières et religieuses de la Basse - Casamance, notamment, le Roi d'Oussouye et les autorités de Cabrousse, afin de solliciter leur avis. En cas d'avis contraire, le Président de la République a indiqué que le Sénégal demandera au Mali une concession pour y édifier un symbole digne du rang de notre héroïne nationale. » (Communiqué du conseil des ministres du Sénégal, 15 décembre 2011). Depuis, plus rien, jusqu’en 2019. Cette année-là, le militant des droits de l’homme, Alioune Tine a « reveillé » le dossier de Aline Sitoë. Il venait d’effectuer une mission à Tombouctou ; mission au cours de laquelle il a pris certaines informations.
Tine a placé son plaidoyer au plus haut niveau politique en interpellant directement le Président Macky Sall et Abdoulaye Baldé, le maire de Ziguinchor. Que dit Tine ? « Nous demandons solennellement au Président de la République Macky Sall et le maire de Ziguinchor Abdoulaye Balde de prendre toutes les initiatives diplomatiques opportunes auprès de leurs homologues maliens pour que le corps de Aline Sitoë Diatta soit rapatrié à Cabrousse auprès des siens », a-t-il lancé, sur sa page électronique. « Le Sénégal doit absolument promouvoir la mémoire de cette héroïne qui a été déportée comme d'autres résistants africains au colonialisme, comme Samory Touré, Serigne Cheikh Bamba Mbacké. », a-t-il ajouté. Ses arguments, il les tire encore de l’histoire, car « ne pas honorer la mémoire de Aline Sitoë, c'est comme la punir une deuxième fois après sa déportation, en confinant sa tombe dans un anonymat infamant.'' !
Ainsi donc, Alioune Tine entendait réussir une grande « mobilisation de l'opinion pour rapatrier au Sénégal la dépouille de l'héroïne Aline Sitoë Diatta enterrée de façon anonyme au milieu de nulle part à Tombouctou » ! Alioune Tine donne des informations capitales de façon pathétique. Il écrit : « Elle a été enterrée devant sa maison, juste devant le lit d'une rivière asséchée, pratiquement seule au monde ». « Les inscriptions en arabe sur sa tombe ont été effacées par les groupes armés djihadistes. La tombe est gardée par une famille musulmane très pieuse…. ». Il affirme avoir pu se recueillir sur la tombe
…. LES NECESSAIRES RECOUPEMENTS
Sur ce chapitre, il convient de relativiser le cri de coeur de Aliou Tine, car les faits se présentent autrement à Tombouctou. Tine et les autres sources, dont certaines sont encore vivantes, ne sont pas concordantes sur la matérialité des faits se rapportant à la mort de Aline Sitoë Diatta. Tine s’est, peut-être recueilli sur une tombe qui n’était pas celle de la grande dame de Casamance. Papis Fall reste toujours notre principale source d’information. Il est d’une grande précision dans le déroulement des faits qu’il écrit, que Aline a été placée dans « le camp des internés ». Aujourd’hui, cette place est occupée par l’école fondamentale qui porte le nom de « Bahadou Boubacar ».
Saloum Ould Elhaj, un instituteur et un historien de Tombouctou, d’une grande réputation confirme ces propos. Il nous a précisé, au cours d’une conversation téléphonique, que l’école « Bahadou Ben Boubacar » dont il s’agit est l’ancienne « école nomade » de Tombouctou ; école qui a connu des enseignants illustres comme Modibo Kéïta, le futur président de la République du Mali. Dans le camp des internés, rapporte Fall, Aline sera mise à l’isolement. Elle qui vient de la forêt va manquer de fruits. Sa santé ne va pas tarder à se dégrader. Elle est transférée au dispensaire local où elle va rendre l’âme, le 22 mai 1944. Elle a souffert du scorbut, une avitaminose sévère. La date du 22 mai est aussi celle qui a été communiquée, dans un rapport, par le président Abdou Diouf, sur la base d’une enquête menée à Tombouctou en 1989. Cependant, Jean Girard qui a travaillé de façon indépendante sur le même sujet ( « Genèse du pouvoir charismatique en Basse Casamance (Sénégal) », (Institut fondamental d'Afrique noire », (1969) avance une autre date qui se situerait en 1946. Mamadou Nkruma Sané, un des leaders du mouvement indépendantiste casamançais ne retient pas lui aussi la date du 22 mai, comme celle de la mort de Aline. Il penche pour 1945, car , soutient-il, à cette date, il dispose d’informations , notamment un rapport médical qui recommandait à l’administration coloniale de libérer Aline et son mari.
Aline, dit Sané, n’était même pas morte. Ses assurances, les voici : « Je peux vous confirmer qu’elle est vivante quelque part puisque son mari qui est plus âgé qu’elle n’est disparu qu’aux environs de 1998. La reine avait été arrêtée les 28-29 janvier 1943. Elle n’avait que 23 ans. En plus, elle n’a jamais été déclarée morte par ceux qui l’ont arrêtée et l’ont incarcérée à Tombouctou. C’està-dire l’autorité coloniale de l’époque. C’est cette même autorité coloniale qui a produit le document que je mets à votre disposition. Lequel document me dit qu’elle a été libérée vivante avec son mari et le reste des Casamançais qui étaient emprisonnés avec elle à Saint-Louis, Matam, Podor et Kayes. C’est elle seule qui n’a pas pu regagner sa terre natale.
Par contre son mari est rentré. Vous verrez le décret colonial qui avait motivé son arrestation et le second décret qui avait donné l’autorisation de la libération des détenus politiques casamançais arrêtés pendant la période coloniale. » ( Wal fadjiri, 2007, repris sur le site du Soleil, 26 décembre 2007). Sur la mort même de Aline Sitoë Diatta, Saloum Ould Elhadj est catégorique. Il parle de la consignation de ce décès dans le registre de la mairie de Tombouctou, document aujourd’hui malheureusement disparu depuis l’entrée barbare des djihadistes dans la ville en 2012. Saloum Ould El Hadj et plusieurs autres sources qui ont travaillé sur l’identification de la tombe de Aline Sitoë sont formels.
Aline repose, non pas au bord d’un quelconque ruisseau, mais bien au cimetière qui porte le nom de Sidi El Ouaffi Araouani, sis à Sarey Keyna, à quelques pas seulement du dispensaire où a été constaté le décès de la « dame de Kabrousse ». Du reste, se demande Saloum Ould Elhadj : « pourquoi l’enterrer au bord d’un ruisseau alors qu’il y a un cimetiere à moins de cent mètres ? » Saloum Ould Elhaj a les preuves de son affirmation en la personne de Gobi, à l’époque, Maçon du cercle de Tombouctou. C’est à ce titre, qu’à l’aide de quelques prisonniers, il a procédé à l’inhumation du corps. Cette version locale est crédible. Elle détruit littéralement les assertions de Alioune Tine qui dans son plaidoyer, affirme que « Aline a été enterrée devant sa maison, juste devant le lit d'une rivière asséchée, pratiquement seule au monde.
Les inscriptions en arabe sur sa tombe ont été effacées par les groupes armés djihadistes.La tombe est gardée par une famille musulmane tres pieuse qui nous a révélé que Aline Sitoé Diatta est considérée comme une sainte dans la ville aux 333 saints qu'est Tombuctou ». Outre Saloum Ould Elhadj, nous avons également pris contact avec Modibo Sidibé, un enseignant natif de Tombouctou. Modibo Sidibé qui a effectué de solides études en histoire est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Bamako, promotion 1985. Il est très engagé dans la vie de la communauté. Au cours d’une entretien téléphonique, il nous a donné une confirmation irréfutable de l’existence d’une tombe au nom de Aline Sitoë Diatta à Sareykeyna. Au cours d’une visite, il a été surpris de constater qu’une stèle avait été posée sur un emplacement qui jouxtait une des tombes qu’il était venu visiter dans le cimetière cité.
La stèle était récente. Donc, Aline repose bien à Tombouctou et non « au mileu de nulle part ». L’épitaphe dit ceci : « Ici repose Ainsétou Assétou, Aline Sitoé Diatta, Décédée 29 Mai 1944 à Tombouctou ». Bien sûr que cette annotation induit de nouvelles interrogations. La première est relative au nom « Ainsétou Assétou ». Est-ce le nom par lequel, la résistante a été adoptée à Tombouctou ? Il y a une sorte d’homophonie qui peut soutenir cette hypothèse. La deuxième porte sur la date du décès de la personne. L’épitaphe parle du 29 mai, alors que les documents évoqués avant retiennent la date du 22 mai 1944. C’est dire que la confusion n’est pas encore à son terme. Il reste que la jeunesse de Tombouctou ne sait quasiment pas qui a été Aline Sitoë Diatta, qu’est ce qui l’a conduit ici et comment elle est passée dans la postérité mémorielle de son pays.
Au Sénégal, plusieurs infrastructures porte son nom : des écoles, des stades, une résidence universitaire, le ferry qui relie Dakar à Ziguinchor,….
Le sens de son combat doit être entretenu et évoqué dans la mémoire, car plus que la Casamance et le Sénégal, Aline est une combattante de la liberté pour l’Afrique. Elle ne se battait pas pour les femmes, mais pour son peuple. Il ne faut jamais perdre de vue qu’elle a été une victime, elle aussi, des partisans de Vichy. Elle est une preuve de la négation des droits de l’homme, tout court. La ville de Tombouctou pourrait ériger un monument en la mémoire de cette héroïne. Ne s’agit- il pas ici aussi d’un autre bien culturel ? Cela, au nom de la légendaire fraternité qui lie Tombouctou à la grande communauté sénégalaise, bien au-delà de la colonisation française. En témoignent la broderie, la musique, les arts culinaires, les échanges religieux…
*Paru dans L’Essor, le Quotidien national d’information du Mali, « Supplément culturel », du 12 mars 2021
DOCUMENTS CONSULTÉS
Archives d'outre-mer d' Aix-en-Provence, 14 MI 1835 2G 42, Rapport politique du Sénégal Archives Nationales du Sénégal, Rapport d’interrogatoire du 15 mars 1943 Christian Roche, Chronique casamançaise. Le cercle de Ziguinchor au Sénégal pendant la guerre de 1939-1945, Outre- Mères, revue d’histoire, 1986 Communiqué du conseil des ministres du Sénégal, 15 décembre 2011 Jean Girard, intitulé : Genèse du pouvoir charismatique en Basse Casamance (Sénégal), 'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan), 1969 Le Soleil , Histoire d’Aline Sitoe : mourir à Tombouctou, , mardi 11 octobre 1983, p.2 Papis Comakha Fall, « Automne-hiver 2020 » (page 19, n° 9-10) Télégramme lettre n° 31 adressée au gouverneur général de l’AOF, Saint Louis, 22 janvier 1943